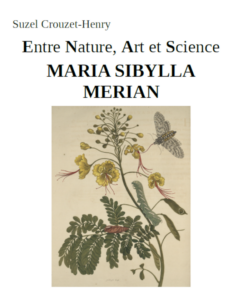La Renouée bistorte, une jolie plante
Bistorta officinalis
C’est une plante qu’une amie m’a présentée récemment. Bistorte, un nom curieux. Renouée, ça m’a fait un peu peur. Je voyais déjà mon jardin envahi de renouées, mais la Bistorte, ce n’est quand même pas la Renouée du Japon. Elle n’est pas vraiment invasive, et a même tendance à ce raréfier dans certaines régions. Je ne sais pas s’il y a là de quoi se réjouir, d’autant que la plante a quelques vertus.
La Serpentaire (ou Couleuvrée)
C’est ainsi qu’on nomme parfois cette renouée dont le rhizome puissant, tordu par deux fois, a la forme de serpent. C’est une plante bistorte. Conformément à la théorie des signatures, chère aux Anciens, elle aurait le pouvoir de soigner les morsures de serpent. Selon la mythologie, la Renouée bistorte serait liée à Hélène, la femme de Ménélas, cette beauté ravageuse de l’Antiquité partie avec Pâris et à l’origine de la guerre de Troie. Après avoir récupéré sa femme, Ménélas se rendit en Égypte avec elle. Hélène, voyant Canopos, le pilote de leur bateau, mourir d’une morsure d’un serpent, fondit en larmes, ce qui donna naissance à la Bistorte. Ce n’est d’ailleurs pas la seule plante liée à Hélène. C’est aussi la cas de l’Aunée (Inula helenium) qu’Hélène aurait eu dans la main lors de son enlèvement par Pâris (selon Pline l’Ancien). Un autre version fait naître cette plante des larmes qu’aurait versées Hélène à cette occasion. Des larmes et des morsures de serpent, encore ! Cette plante aurait en effet le pouvoir, d’après Pline et Discoride, de protéger des morsures de cet animal. De quoi, confondre l’Aunée avec notre Bistorte ! Mais les fleurs de la première sont de la couleur du soleil, alors que celles de la seconde sont roses.
La Renouée bistorte aime les zones montagneuses fraîches et humides. Elle est pérenne. Sa tige, ronde avec des nœuds, d’où son nom de Renouée, peut atteindre plus de 80 cm. La plante appartient à la famille des Polygonacées, comme la Rhubarbe, l’Oseille ou le Rumex. Les feuilles basales, d’environ 20 cm, sont pointues, vertes sur le dessus, grisâtres au-dessous. Elles se rétrécissent brusquement à la base et se prolongent le long de la tige, on parle de pétiole ailé, ce qui vaut à la Bistorte le nom populaire de Langue-de-bœuf. Les feuilles supérieures sont plus minces et sans pétiole. Elles sont dites sessiles. Au sommet de chaque tige, se trouve un épi unique, de 4 à 5 cm de long, parfois même de 9 cm, portant de nombreuses fleurs roses. L’inflorescence ressemble à celle de l’Orchidée, mais les nervures des feuilles permettent de distinguer les deux plantes. Chez l’Orchidée, elles sont parallèles, tandis que chez la Bistorte, elles partent toutes d’une épaisse nervure centrale.
Une plante-hôte
La Bistorte joue un rôle clé dans la survie de nombreux insectes présents dans les prairies humides de nos montagnes. Son nectar et son feuillage en font une ressource alimentaire essentielle. Deux espèces rares de papillons dépendent étroitement d’elle. La Bistorte est leur plante-hôte. Les femelles pondent sur ses feuilles qui vont servir plus tard de nourriture aux larves. Allez, je me lance. Il me faut bien, comme Maria Sibylla Merian, décrire ces lépidoptères et m’intéresser un peu à leurs chenilles.
Le Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle) est une relique glaciaire. Il occupe les sites marécageux froids des zones montagneuses. L’insecte parfait est attiré par la Renouée bistorte, indispensable au développement de ce petit lepidoptère menacé par le réchauffement climatique. Les mâles présentent un dessus violet et un dessous orangé taché de noir et de blanc. Les femelles sont souvent posées et donc plus difficilement détectables que les mâles. Après l’accouplement, elles volent lentement au ras de la végétation pour choisir une feuille de bistorte. Elles déposent un ou deux œufs sur la face inférieure de la feuille et reprennent ensuite leur exploration. Les œufs incubent 5 à 9 jours. La croissance des chenilles dure 4 à 5 semaines. Leur couleur varie du jaunâtre au vert pomme en fonction du stade de développement. Elles hivernent au stade de chrysalide dans la litière végétale jonchant le sol.
La seconde espèce, le Nacré de la Bistorte (Boloria eunomia), n’est présent en France que dans l’Est des Pyrénées, les Ardennes et le Morvan. La face supérieure des ailes est orange à taches arrondies alignées ; la face inférieure porte une série de petits ocelles noirs à centre blanc. La chenille, de couleur grise à points blancs, possède des épines blanches ou roses.
D’autres espèces fréquentent aussi la Bistorte, même s’ils en sont moins dépendants. Il n’est qu’à citer le Petit collier argenté (Boloria selene), une espèce quasi menacée. C’est un papillon au dessus orange orné de dessins de couleur marron formant des chevrons. Le revers est plus clair. Les chenilles sont de couleur beige et portent des épines jaunes et noires.
Une plante bénéfique
La plante est comestible et peut être utilisée à des fins thérapeutiques. Attention cependant en la cueillant, son suc peut être irritant. Autre chose à savoir : comme toute plante contenant des tannins, la Bistorte ne supporte par le contact du fer.
Ses feuilles renferment de l’amidon et ont un goût un peu acide. Les feuilles, les tiges et les rhizomes de la Renouée bistorte étaient consommés de manière courante dans certains pays d’Europe du Nord et d’Asie. Les jeunes feuilles et tiges se consomment comme des épinards cuits, les rhizomes comme des féculents. Ces derniers nécessitent plusieurs cuissons. Les Anglais utilisent la Bistorte pour faire un pudding. La richesse en acide oxalique de cette plante oblige à la consommer de manière très modérée, des troubles digestifs peuvent survenir.
L’usage médicinal de la Bistorte est ancien. Sa richesse en tanins en fait une plante médicinale astringente, qui favorise la cicatrisation. Parmi les herbes aromatiques qui sont mentionnées dans le capitulaire De Villis, édicté vers l’an 800 par Charlemagne, on trouve la Dragantea identifiée actuellement comme la Serpentaire. Reste à savoir s’il s’agit de notre Renouée ou de l’Estragon, cette plante étant censée, elle aussi, soigner les morsures de serpent. Plus près de nous, la Bistorte rentrait dans la composition du diascordium, un remède de la pharmacopée maritime du XVIIe siècle. De nos jours encore, les chercheurs démontrent régulièrement les propriétés médicinales de cette plante, réputée pour son action anti-inflammatoire.
La Renouée bistorte est une bien jolie fleur, avec tout plein d’avantages que ce soit pour les papillons, ou pour nous. Il serait bien dommage de s’en priver.

 lescouleursdesuzel
lescouleursdesuzel lescouleursdesuzel
lescouleursdesuzel LoggaWiggler de Pixabay
LoggaWiggler de Pixabay Hans, Pixabay
Hans, Pixabay Kunstmuseum Solothurn, Soleure
Kunstmuseum Solothurn, Soleure Ralph, Pixabay
Ralph, Pixabay