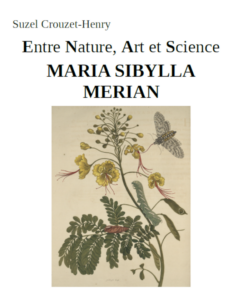Le Rumex, une vraie sauvage
A conserver ou pas au jardin ?
Que penser du Rumex ? C’est pour moi une vraie interrogation. J’en ai dans mon jardin, j’en ai même de plus en plus. Il y a quelques années, j’ai laissé sur place un pied ou deux. Je savais que certains appellent cette adventice Oseille sauvage (ou Patience) et il me semblait judicieux de la laisser s’épanouir un peu. Je ne la trouvais pas vraiment belle, au demeurant, avec ses grandes feuilles lancéolées d’un vert plus que sombre et une floraison pas vraiment attractive, mais c’était une sauvage et elle avait le droit d’exister comme d’autres que je laisse au jardin par curiosité et respect du vivant. Actuellement, j’ai quelques pieds de plus, pas vraiment une invasion, mais un début de colonisation. Alors, je me suis décidée à étudier de plus près cette plante et à en arracher quelques nouveaux pieds déjà bien installés. C’était il y a un mois, et les pieds en question, qui ont bien repoussé, portent déjà une hampe florale. Une plante décidément coriace ! A-t-elle un intérêt quelconque ? Il faut décidément chercher plus loin.
Plusieurs espèces de Rumex
Il y a de nombreuses espèces de Rumex. Deux sont très courantes sous nos latitudes : le Rumex à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) et celui à feuilles crépues (Rumex crispus). Leurs feuilles permettent donc de les distinguer, mais pour le reste il n’y a pas grande différence. Ce sont des plantes de la famille des Polygonacées comme l’Oseille, la Rhubarbe ou la Renouée bistorte. Une peau recouvre leur nœud sur la tige. Les rumex peuvent atteindre 1, 20 m de hauteur. Leur système racinaire est particulier : leur racine pivotante, très longue, est surmontée d’un collet dont il faut se méfier. C’est à partir de lui que peut repartir la plante après un arrachage bâclé qui l’aurait laissé en place. La hampe florale change de couleur avec le temps : elle passe du vert, au rouge, puis au brun. Une plante peut produire chaque année des milliers de graines, d’où l’intérêt si l’on veut s’en débarrasser d’empêcher cette floraison. Trois petites choses à savoir : les graines d’une hampe encore verte peuvent germer ; une hampe coupée peut porter des graines encore viables ; les graines peuvent germer des années plus tard. D’où l’intérêt de ne pas trop laisser traîner la chose au jardin et de ne pas la jeter dans le bac à compost.
Une plante qui a son utilité
Pauvre Rumex ! Il a pourtant son intérêt. Il indique l’état du terrain. C’est une plante bioindicatrice qui pousse sur une terre tassée, compacte, trop riche en matières organiques non décomposées. En fait, c’est sa longue racine qui lui permet d’atteindre les couches plus profondes du sol et de triompher des obstacles qui s’opposent à la croissance des autres plantes. Il restaure ainsi l’équilibre du sol qui s’il est cultivé correctement par la suite peut se passer peu à peu du Rumex
C’est aussi une plante-hôte pour certains insectes. Le Rumex à feuilles obtuses accueille la chenille de l’Écaille martre (Arctia caja). Le corps brun-noir de cette chenille velue est recouvert de touffes de soies serrées, issues de petites verrues blanches. Les soies dorsales et latérales sont d’un brun sombre ; les soies ventrales, plus courtes, rousses. La tête, relativement petite par rapport au reste du corps, est d’un noir luisant. C’est une chenille qui peut se déplacer rapidement et qui se nourrit de plusieurs espèces de plantes, pas seulement du Rumex. Le Rumex à feuilles crépues peut servir lui de nourriture à la chenille d’un papillon de nuit, le Clair-obscur (Aedia leucomelas). Cette chenille, qui se trouve d’ailleurs surtout chez les liserons, change de couleur en fonction de son alimentation. L’insecte peut causer des ravages au jardin, mais le papillon est un bon pollinisateur. Chenilles et insectes parfaits servent de repas aux oiseaux, reptiles, rongeurs, chauves-souris ou araignées. Pas mal pour la biodiversité !
Les pucerons sont aussi attirés par le Rumex qui protège ainsi les autres plantes de leurs ravages. Les coccinelles sont attirées à leur tour par cette réserve de nourriture que forment les pucerons. Le jardinier a ainsi à sa disposition une armée d’auxiliaires et peut se passer des produits insecticides. Garder quelques pieds de Rumex peut être une bonne idée pour tous ceux et celles qui se soucient de l’environnement .
Enfin, il semble que la plante soit comestible, du moins quand elle est jeune et que les feuilles sont encore tendres. Elle comporte, cependant, de l’acide oxalique, ce qui peut provoquer des troubles importants pour tous ceux qui souffrent des reins. Elle est toxique pour les animaux et il faut veiller à ce que les chevaux et le bétail en général n’y touchent pas. Attention aussi à ne pas confondre le Rumex avec l’Arum tacheté (dont toutes les parties sont éminemment toxiques) qui possède lui une nervure qui fait le tour du limbe. Une grande prudence s’impose donc avant de consommer le Rumex. Autant se contenter de l’Oseille du jardinier, qu’il faut également manger avec une grande modération.
S’en débarrasser ?
C’est la grande question. Il faut au minimum éviter la floraison. Un passage à la tondeuse peut régler l’affaire pour quelque temps, mais on l’a vu la plante repousse. Il faut à un moment ou un autre prendre des solutions drastiques. Il y a bien sûr des solutions chimiques, mais je refuse d’y avoir recours. D’autres plantes que le Rumex en souffriraient. Il reste la solution la plus ardue, s’armer de courage, et utiliser une gouge, un couteau costaud, une bêche, afin d’extraire la racine ou au moins le collet, puisque la plante se propage non seulement par les graines, mais aussi par la multiplication dudit collet.
Que vais-je donc faire de cette plante ? Je vais en enlever quelques pieds à l’automne et en garder un ou deux pieds, idéalement situés près de mon mini potager afin de garder une réserve de nourriture pour les coccinelles. Et puis, au printemps je ferai attention à ne pas laisser les pieds se propager trop loin. Du travail en perspective !


 lescouleursdesuzel
lescouleursdesuzel lescouleursdesuzel
lescouleursdesuzel LoggaWiggler de Pixabay
LoggaWiggler de Pixabay Hans, Pixabay
Hans, Pixabay Kunstmuseum Solothurn, Soleure
Kunstmuseum Solothurn, Soleure Ralph, Pixabay
Ralph, Pixabay