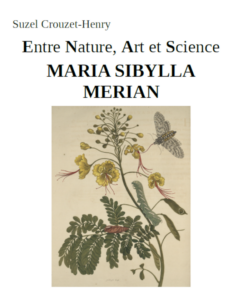Madame de Pompadour à son métier à broder, tableau de François-Hubert Drouais, 1763-1764
Les indiennes
Une mode durable
J’ai longtemps hésité à écrire cet article sur les indiennes, ces cotonnades peintes et imprimées ramenées des Indes par les Portugais à la fin du XVIe siècle et copiées ensuite par les Européens. La complexité du sujet et son vocabulaire assez technique m’ont sans doute arrêtée dans mon élan. Aujourd’hui, c’est décidé, je m’y mets. Je vais essayer de faire simple, et j’espère, efficace. Derrière cette volonté de faire connaître l’histoire des indiennes, il y a d’abord une préoccupation de couturière. On constate toujours, en effet, un vif engouement pour les cotonnades imprimées fleuries, filles des indiennes d’autrefois. Elles sont utilisées pour l’habillement et la décoration. Les tissus provençaux sont des incontournables dès qu’il s’agit de confectionner des nappes, des coussins, des dessus de lit, des sachets de lavande, des robes d’été. Les marchés colorés du Sud de la France en proposent à foison et les maisons spécialisées vendent de très beaux accessoires. Derrière cette volonté d’écriture, il y a aussi une curiosité, un goût pour l’exotisme. Le nom d’indiennes lui-même invite au voyage. Les Européens des XVIIe et XVIIIe siècles ont été fascinés par tout ce que les marins au long cours rapportaient des contrées éloignées : thé, café, porcelaines, éventails, pétards de Chine, curiosités, tissus divers. Nous pouvons avec l’histoire des indiennes les accompagner un peu dans cet émerveillement.
Des tissus qui ont surmonté tous les interdits
Pour comprendre l’histoire des toiles peintes ou indiennes, il nous faut d’abord nous tourner vers l’Inde, foyer d’origine de ces tissus. Le coton y est connu dès le Néolithique et il aurait servi à fabriquer des vêtements dès 2000 av. J.-C. Depuis ces temps reculés, les artisans indiens se transmettent les secrets de la fabrication des toiles de coton imprimées. Ils utilisent des plantes tinctoriales (garance, indigo) ainsi que des mordants (sels de fer et d’alun). Ces derniers permettent aux couleurs de pénétrer la fibre du coton.
Les toiles peintes, originaires d’Inde, sont distribuées en France par la Compagnie française des Indes orientales, fondée sous Louis XIV par Colbert en 1664. Appelées indiennes ou calicots (de Calicut en Inde), elles font rapidement fureur. Il faut noter, cependant, que sous ces noms on trouve aussi des tissus venus de Perse ou de l’Empire ottoman.
Marseille, port franc, est la première ville française à voir s’établir des fabriques de toiles peintes. En 1672, une colonie de négociants et d’artisans arméniens s’y installe et améliore considérablement la qualité de ces indiennes. C’est la naissance des boutis provençaux, la broderie et le matelassage étant en effet intimement liées à la fabrication des toiles peintes. Le jupon en boutis devient vite un incontournable des trousseaux de mariage des Provençales.
En octobre 1686, la production et la vente de toiles peintes, qu’elles soient importées des Indes ou imprimées en France, sont interdites. Cet arrêt contribue à la décadence de la production française de toiles imprimées, déjà bien mise à mal par la révocation de l’Édit de Nantes en 1685. La plupart des fabricants sont, en effet, des protestants et ils ont dû émigrer. L’art de l’impression sur étoffe est perdu en France pour longtemps.
De 1686 à 1759, la contrebande permet de faire entrer les indiennes étrangères dans le royaume par les régions frontalières et les ports. Les lieux de production se spécialisent, Bâle dans les indiennes bleues, Mulhouse dans les rouges. Les Français ont un véritable engouement pour ce type de tissu et veulent le porter, si ce n’est à l’extérieur, au moins à l’intérieur de leur maison. La robe de chambre fait l’affaire.
La législation est donc sans cesse tournée. Il n’y a rien à faire, le public préfère les indiennes aux autres étoffes, et Mme de Pompadour la première. La liberté de fabrication est obtenue en 1759. Les manufacture d’indiennes deviennent de plus en plus nombreuses. Les toiles peintes sont partout. Elles sont utilisées pour les vêtements, mais aussi dans la décoration et l’ameublement. Dans la plupart des cas, les toiles n’étaient, cependant, pas tendues sur les murs. On leur préférait les papiers peints, quitte à reprendre les motifs des tissus utilisés pour les meubles.

Indienne « Le Grand Corail », musée du textile de Wesserling, Alsace, photographie Rémi Stosskopf
Des motifs qui séduisent toujours
Très vite, les motifs des indiennes diffèrent de ceux de leurs région d’origine, même en Inde. Il s’agit de répondre aux goûts de la clientèle européenne. Quant aux manufactures françaises, si elles emploient leurs propres dessinateurs, elles sollicitent également des artistes spécialisés dans le dessin sur soie. C’est ainsi que dans les années 1760 et 1770, elles utilisent des motifs que l’on retrouve sur les tissus en soie. La robe portée par Mme de Pompadour dans le tableau de Drouais est souvent décrite comme une indienne, mais j’y vois plutôt une soierie. Il y a un goût certain du XVIIIe s. pour la nature. À la fin des années 1780, les fleurs des champs envahissent les indiennes. Les bonnes herbes se déclinent sur fond écru ou sur fonds de couleurs brune ou bronze, dits ramoneurs.
Le décor des indiennes évolue. Si les motifs végétaux et animaux sont toujours employés, la représentation humaine prend de plus en plus d’importance. Et là, il nous faut parler de la manufacture de Jouy-en-Josas, créée en 1760 par Christophe-Philippe Oberkampf près de Versailles, et de ses toiles ornées de scènes bucoliques, de sujets antiques ou d’événements contemporains (le vol en ballon des frères Montgolfier en 1783, par exemple). Dans les années 1660, l’impression des toiles se fait à l’aide de planches de bois gravées. Par la suite, des planches de cuivre sont utilisées pour l’impression, ce qui permet une plus grande finesse des motifs et une mécanisation de la production. Celle-ci progresse encore avec la machine à imprimer au rouleau utilisée à partir de 1797. Cette impression au cylindre contribue à la diffusion de motifs nouveaux, cachemires aux fines stries, ou ondulations avec jeux d’optique. Elle permet aussi la reproduction facile de petits motifs répétitifs, les mignonnettes. L’impression ne permet pas d’obtenir tous les coloris. Jusqu’en 1808, date de l’invention du vert solide, les pinceauteuses doivent superposer du jaune et du bleu pour obtenir du vert. De petits motifs stylisés aux couleurs vives à fonds verts, rouges ou bleus vifs sont imprimés à Jouy dans les années 1810. Ils sont à l’origine des tissus provençaux d’aujourd’hui. La toile de Jouy, connue pour ses décors monochromes, est toujours utilisée dans les domaine de la mode, de la décoration et de l’ameublement.

Toile dite de Jouy contemporaine
Et l’écologie dans tout ça ?
Il m’a fallu bien vite me rendre à l’évidence, la fabrication des indiennes n’a rien d’écologique. La manufacture d’indiennes préfigure déjà l’usine contemporaine avec la concentration des bâtiments industriels, des moyens de production et des hommes. En créant régulièrement de nouveaux dessins, les fabricants encouragent, dès le XVIIIe s., une société de consommation, au moins dans les classes aisées. L’indiennage contribue à l’essor de l’industrie chimique avec l’utilisation du chlore. Il participe bel et bien à la révolution industrielle du XIXe s et à la dégradation de l’environnement.
Je m’en voudrais de finir sur une note négative. La réutilisation des tissus permet d’atténuer les effets pervers décrits plus haut. Sous l’Ancien Régime, les vêtements des plus riches sont retaillées pour s’adapter à leurs nouveaux propriétaires. Beaucoup de courtepointes provençales du XVIIIe s. sont composées de divers morceaux d’indiennes assemblés pour l’occasion. Et de nos jours ? Le patchwork permet d’utiliser au mieux les chutes de nos cotonnades fleuries. Comme bien souvent, l’économie de moyens et de biens est la meilleure façon de préserver la nature et l’environnement.
À lire aussi
Cliquer ici pour ajouter votre propre texte

 lescouleursdesuzel
lescouleursdesuzel lescouleursdesuzel
lescouleursdesuzel LoggaWiggler de Pixabay
LoggaWiggler de Pixabay Hans, Pixabay
Hans, Pixabay Kunstmuseum Solothurn, Soleure
Kunstmuseum Solothurn, Soleure Ralph, Pixabay
Ralph, Pixabay